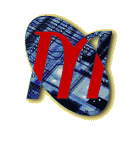

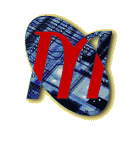
|

|
|
ENTREVUE AVEC YOSHIO SHIRAKAWA ET MASASHI OGURA À l’occasion des expositions : Yoshio Shirakawa et Les avant-gardes au Japon 1920-1970 présentées au Centre international d’art contemporain de Montréal dans le cadre de l’année canadienne de l’Asie-Pacifique du 6 novembre au 21 décembre 1997. Rossitza Daskalova : L’avant-garde est un concept important dans l’art occidental et les artistes dont le travail a été qualifié ainsi sont parmi les personnages les plus importants de l’histoire de l’art moderne. Quelle était l’emprise de l’avant-garde au Japon et l’influence de ces artistes? Masashi Ogura : Lorsque nous faisons référence à l’avant-garde au Japon, nous distinguons deux étapes importantes: avant la deuxième guerre mondiale et après celle-ci. Au Japon d’avant la guerre, une forte occidentalisation se faisait sentir dans tous les domaines de la culture : en littérature, en théâtre et en beaux-arts notamment. L’avant-garde est issue d’un contexte où émergeait un désir de transformer la société japonaise sous l’influence des idées socialistes de la Russie et de l’Europe. Les avant-gardes japonaises d’alors s’inspiraient des mouvements français, allemand ou russe. Yoshio Shirakawa : À l’époque de Meiji (1867-1911), un système européen (français et italien) d’éducation, de musées et de beaux-arts était en place. Au début des années 20, un système moderne fonctionnait déjà. L’avant-garde qui émerge dans cette époque était underground, contre le système officiel, contre le gouvernement. M.O. : Dans les années 30, la crise économique a provoqué une rémontée du militarisme japonais et du nationalisme. L’empire japonais a réprimé cette tendance avant-garde. En 1939, avec le début de la guerre du Pacifique, les activités des artistes de l’avant-garde s’arrêtent. Y.S. : Dans les années 1920, les artistes proposent que l’art existe dans la société, qu’il peut être politique. Pour la première fois, ils ont tésté et senti les limites de l’art, tout en réfléchissant sur la définition et le rôle de l’art dans la société. En conséquence, quelques artistes ont voulu apprendre les théories socialistes et le marxisme, en particulier, afin de les utiliser dans leur production artistique. Ils croyaient alors qu’en changeant l’art, ils pouvaient changer la société et vice versa. R.D. : Quelles traces ces avant-gardes de l’avant guerre ont-ils laissées? M.O. : Avec la fin de la guerre en 1945, ceux qui ont dû garder le silence pendant la guerre, ont repris les activités dans tous les domaines culturels et, parmi eux, des artistes d’avant-garde. Ce sont eux qui ont gardé la mémoire de l’avant-garde d’avant la guerre. Il ont établi une continuité entre les mouvements d’avant-garde d’avant et d’après la guerre. R.D. : Comment les avant-gardes passées sont-elles perçues au Japon? Ont-elles une importance dans l’art contemporain japonais et une influence sur le travail des artistes d’aujourd’hui au Japon? M.O. : L’art d’aujourd’hui est un produit de la société de consommation et, dans les années 80, la société japonaise a connu une grande prospérité. En même temps, la culture poursuivait toujours le processus d’occidentalisation (surtout d’influences française et allemande) établi à la période Meiji et subissait l’américanisation suite à la deuxième guerre mondiale. Lorsque nous parlons de notre contexte actuel, l’avant-garde japonaise ne suiscite pas un grand intérêt. Néanmoins, il y a un petit nombre d’artistes et de critiques qui tournent leur regard vers l’avant-garde et soulignent l’importance de connaître le passé dans le but de mieux comprendre le présent et analyser l’art contemporain. D’un autre côté, dans notre contexte postmoderne, une tendance à s’intéresser au passé se fait remarquer, notamment un intérêt pour l’avant-garde. Par example, quelques artistes ont reconstruit des performances de l’avant-garde d’une façon postmoderne, semi-ironique. Ce qui rend ces manifestations ambiguës, c’est qu’elles ont été présentées dans des galeries commerciales. Y.S. : Les avant-gardes japonaises n’étaient pas très connues au Japon surtout avant les années 80. L’intérêt pour les avant-gardes japonaises était plus grand en Occident qu’au Japon. Par contre, dans les années 80 sous l’influence des philosophes français, les critiques d’art japonais ont annoncé que l’avant-garde n’existe plus, que son concept et sa problématique appartiennent au passé. L’opinion actuelle la plus répandue au Japon veut que leur art, fondé sur une idéologie socialiste et inutile, est l’expresssion d’une utopie sociale. La critique affirme qu’il est inutile de discuter des problèmes politiques dans l’art. L’avant-garde est considérée comme du passé et ce qui est le plus reconnu et apprécié dans l’art contemporain d’aujourd’hui c’est ce qui paraît nouveau et stimulant, comme l’art influencé par les mass-médias. Alors, l’ésthétique prédominante est superficielle et je pense qu’en ce moment il est essentiel d’avoir un recul et un esprit critique. C’est pour cette raison qu’il est important aujourd’hui de garder en mémoire les productions de l’avant-garde et de les faire connaître. R.D. : M. Shirakawa, en 1983 vous avez organisé l’exposition «Le mouvement Dada japonais» au musée de Düsseldorf. Quelle a été sa réception en Occident et au Japon? Y.S. : En Occident, la réaction a été très positive. Au Japon, les critiques ont déclaré que je ne suis ni un critique, ni un chercheur. Donc, ils jugaient l’exposition comme un travail d’amateur. R.D. : Et votre œuvre, comment est-elle perçue au Japon? Y.S. : À mon retour au Japon en 1983, après des études en arts plastiques en Europe, j’ai eu beaucoup de difficultés. En Europe, j’ai fait mes travaux d’étudiant sauf qu’il n’y avait pas beaucoup de cœur dans ce que je produisais. En même temps, c’est peut-être à travers ce processus que j’ai appris à m’exprimer par moi-même. Au Japon, je pouvais créer ce que je croyais bon et juste, mais lorsque je présentais mon travail et que je parlais de problèmes de formes, d’espace et de culture, mon œuvre était qualifiée de structure primaire et de dépassée. Bref, mon travail était vu comme occidental, proche du style allemand en particulier, parce que j’ai étudié à Strasbourg et à Düsseldorf. Très peu de gens ont apprécié mon travail comme étant le produit d’une recherche personnelle. Je vous signale que ce qui compte, selon la mentalité japonaise d’aujourd’hui, c’est ce qui est à la mode. Au Japon, on regarde ce qui se fait ailleurs, on présente majoritairement des expositions de l’extérieur. Ainsi, les critères esthétiques gravitent autour de la question : est-ce que l’œuvre est à la mode ou pas? M.O. : À partir des années 70, ce qui se fasait au Japon était très différent du style de Yoshio Shirakawa. On a pu remarquer la tendance naturaliste, un peu semblable à l’arte povera. C’était une expression de la matière. À cette époque, la notion plastique de la relation entre forme et matière était très répandue et l’œuvre de Yoshio accentuait le problème de la structure dans l’œuvre. Y.S. : J’ai essayé d’analyser la relation entre la forme et la construction, de construire consciemment un espace et d’y chercher des sensibilités japonaises. R.D. : Dans les œuvres présentées au CIAC quelles sont les références choisies et leurs significations?
R.D. : Donc à travers l’image du diable, vous visez à éclairer l’esprit humain et l’époque dans laquelle nous vivons? Y.S. : Ce personage démoniaque se trouve en enfer et il cherche toujours un moyen d’y échapper mais il n’en a pas. En même temps, il a toujours très faim et très soif, mais tout ce qu’il mange se transforme en feu. Il a toujours envie et n’est jamais satisfait. Je trouve que c’est le cas de notre époque. Il y a une envie illimitée d’avoir. R.D. : Il me semble que le fait que vous ayez choisi de peindre ce «diable-faim» sur un fond de tissus avec des motifs floraux peut créer un effet de contrainte dans l’interprétation de l’œuvre. Y.S. : En partie, le tissu avec les fleurs rappelle le kimono traditionnel. De plus, les fleurs font allusion au bonheur et au paradis, alors que l’œuvre suggère l’idée que l’enfer et le paradis existent toujours un à côté de l’autre. C’est cette ambiguïté que je voulais transmettre. Ces motifs floraux sont aussi originaires des 5e et 6e siècles de Perse et de Chine. Il y a aussi un objet de prière avec les dessins de fleurs qui symbolise le corps du Bouddha et rappelle l’histoire de Bouddha qui rencontre le tigre; le tigre a faim et Bouddha lui donne son corps. Buddha a plusieur vies par ce que il est mort plusieurs fois, il se sacrifie plusieur fois. R.D. : Dans votre article, M. Ogura, vous nous faites part des voies d’interprétation de l’œuvre de Shirakawa et vous parlez de la relation qui existe entre lieu et identité. Qui plus est, vous mentionnez que Shirakawa appartient à une catégorie d’artistes «qui ont réalisé que leur choix était de vivre écartelés entre la culture occidentale et celle de leur pays d’origine.» O.M. : Au cœur de la relation entre lieu et identité se trouve le problème de l’espace public. C’est l’œuvre qui peut apporter un espace public. Ce faisant, elle suscite des questions liées à l’identité, sur l’artiste et la relation entre l’œuvre d’art et l’artiste. Dans le travail de Shirakawa, nous pouvons remarquer que l’œuvre est le produit d’une recherche personnelle et en même temps qu’elle émerge comme un espace public. Y.S. : L’exposition consiste en trois parties qui incarne la mémoire personnelle, les références de l’histoire de l’art japonais, et la relation avec l’espace du CIAC. Je suis arrivé à une unité en représentant la relation entre passé et présent, ainsi que celle entre lieu et identité. Dans la série Form-Place j’ai essayé d’imaginer l’espace du CIAC et j’ai représenté cette projection de moi en étant un autre sur l’espace du CIAC. J’ai fait des dessins sur le tissu de vieux rideaux. R.D. : Alors cette œuvre apprivoise le lieu public en créant un espace qui se situe entre l’espace personnel et l’espace public. Par les voix associatives, elle peut s’ancrer dans un espace public tout en exprimant l’expérience personnelle et en faisant allusion à l’expérience de l’autre. Donc ce travail suggère les liens entre lieu, déplacement et identité. Y.S. : Oui. Par example, mes parents avaient un magasin de mode qui a dû changer de lieu trois fois et j’ai entendu dire que le CIAC avait aussi changé de lieu souvent. O.M. : Dans ce sens, cette œuvre est une dédicace au CIAC.
|