FRANÇOISE SULLIVAN,
les Automatistes et les réactions au surréalisme
dans le Montréal de la Seconde Guerre mondiale
L’année 2024 marque le 100e anniversaire de la publication du « Manifeste du surréalisme », un texte d’André Breton. Nous soulignons cet anniversaire car il convient de rappeler combien le surréalisme a été présent dans la formation et les discours de jeunes artistes de toutes les disciplines à Montréal au cours des années 1940 et jusqu’au milieu des années 1950.
Dans son manifeste, Breton définit le surréalisme comme un « Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. » (André Breton, OEuvres complètes, t. I, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1988, p. 328). C’est ainsi que de jeunes artistes de toutes les disciplines, plus tard appelés Les Automatistes, réuni·es autour de Paul-Émile Borduas, ont partagé leur effervescence pour transformer l’art, pour offrir de nouvelles visées sur la vie et pour défendre de nouvelles valeurs pour la société. Ces artistes sont au courant des nouvelles idées qui font l’actualité des arts en Europe. Paul-Émile Borduas et Fernand Leduc ont tenté d’établir des correspondances et des rencontres avec André Breton qui garde ses distances avec les artistes montréalais·es. La rencontre n’aura pas lieu, mais les idées débattues sous le couvert du surréalisme seront retenues et les artistes de Montréal les interpréteront à leur façon, s’éloignant de la vision de Breton.
Nous présentons ici une entrevue que Françoise Sullivan a donnée à Abigail Susik, professeure d’histoire de l’art à l’université Willamette de Salem & Portland (Oregon) aux États-Unis, sur ce moment charnière de l’histoire de l’art du Québec et du Canada. Nous remercions chaleureusement Abigail Susik de son vif intérêt pour l’oeuvre de Françoise Sullivan et de son efficacité à diffuser notre histoire sur la scène internationale. Nous remercions tout particulièrement monsieur Stéfane Foumy pour son apport financier à la production des publications écrite et électronique de cette entrevue.
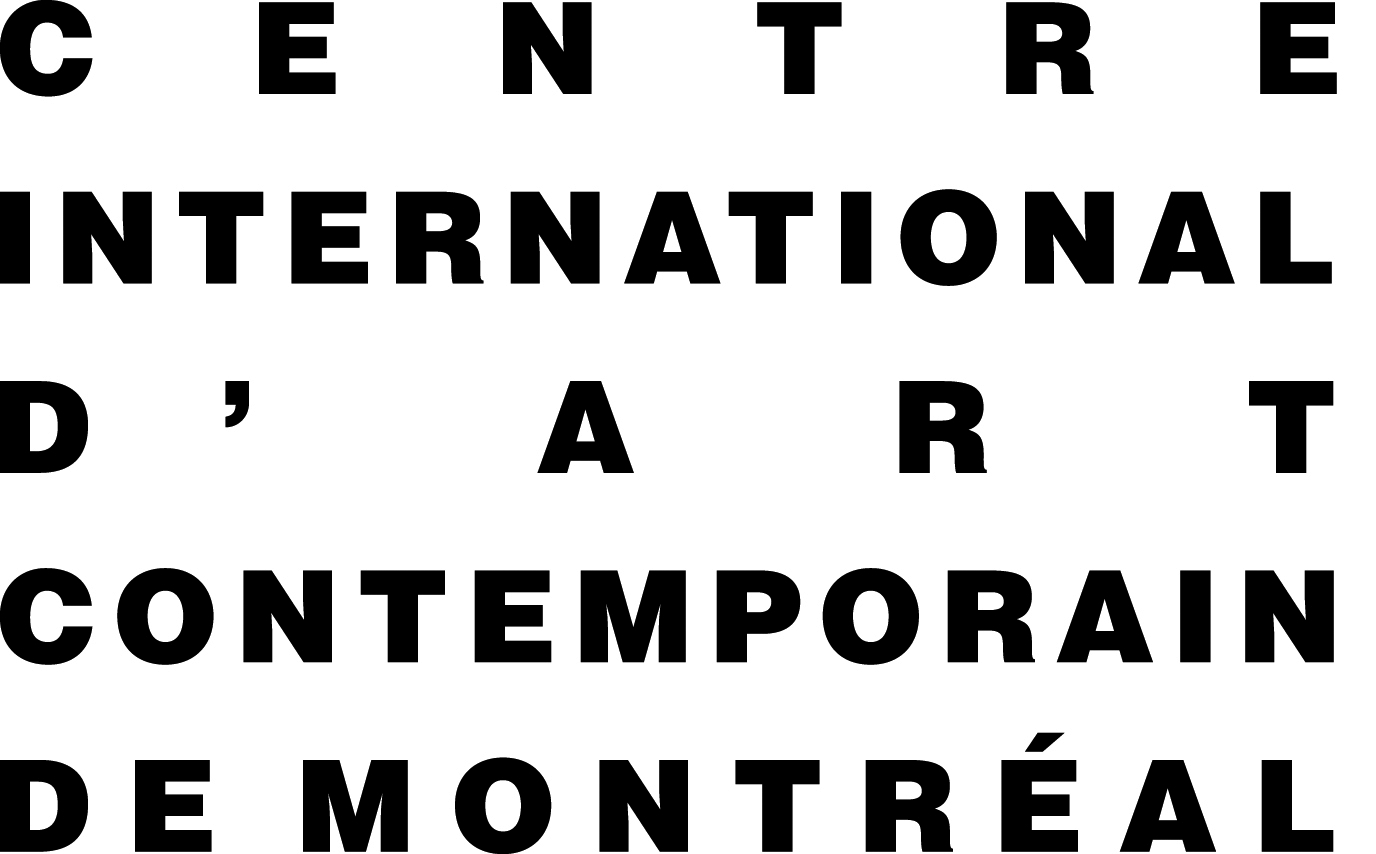
Claude Gosselin, C.M.
Directeur général et artistique
Centre international d’art
contemporain de Montréal
ciac.ca
claude.gosselin@ciac.ca
Cette initiative est rendue possible grâce au soutien du Fonds
Fondation Stéfane Foumy à la Fondation du Grand Montréal.
Correction d’épreuves Colette Tougas
Traduction Anne Viau
Graphisme folio&garetti
Web Jean-Michel Thellen
En octobre 2021, j’ai eu la chance de faire la connaissance de l’artiste visuelle, danseuse et chorégraphe canadienne Françoise Sullivan (née à Montréal en 1923). Nous étions par hasard assises côte à côte à l’inauguration de l’exposition Surrealism Beyond Borders au Metropolitan Museum of Art à New York. Mme Sullivan assistait au vernissage avec son ami Claude Gosselin, directeur du Centre international d’art contemporain de Montréal (CIAC-MTL), pour voir l’installation de photographies documentant sa performance de danse improvisée de 1948, Danse dans la neige, qui avait eu lieu 73 ans plus tôt.
Danse dans la neige fait partie d’une série de solos de danse correspondant aux saisons. Au milieu de la vingtaine au moment de cet événement, Sullivan s’engage dans une performance automatiste éphémère en hommage à la saison hivernale et au paysage nordique du Québec. Elle est alors membre du groupe montréalais Les Automatistes (actif entre 1941 et 1953) et l’événement singulier Danse dans la neige est documenté ce jour-là par deux membres du groupe, les seules personnes à assister à la performance : Maurice Perron, qui prend des photographies, et le peintre Jean Paul Riopelle, qui filme l’événement (les images ont depuis été perdues). Les photographies de Perron au Metropolitan Museum of Art montrent Sullivan se déplaçant dans la neige avec une expression à la fois alerte et calme. Elle porte des gants, un bonnet et des vêtements d’hiver, tandis que son corps interagit spontanément avec la nature environnante.
Au cours de notre conversation au musée ce soir-là, Sullivan m’a expliqué que sa performance d’automatisme corporel de Danse dans la neige était en fait l’expérience d’un état de transe. J’avais tellement de questions sur cette expression physique d’automatisme, son lien avec le groupe des Automatistes et sa relation avec le surréalisme international, que nous avons convenu de poursuivre la conversation sur ces sujets au cours du mois suivant. Cet entretien, enregistré en novembre 2021, est le fruit de notre discussion.
À Françoise Sullivan
à l’occasion de son 100e anniversaire,
le 10 juin 2023
ABIGAIL SUSIK : Votre découverte du surréalisme a-t-elle coïncidé avec votre engagement dans le groupe des Automatistes et votre exploration de la danse comme mode d’expression ? Pouvez-vous me parler de votre milieu à cette époque à Montréal, en pleine Seconde Guerre mondiale ?
FRANÇOISE SULLIVAN : Au début, je crois que j’en savais peu sur le surréalisme, parce que les professeurs de l’École des beaux-arts de Montréal n’en parlaient jamais et qu’il n’y avait rien dans la bibliothèque de l’école. Tout ce qu’on pouvait y trouver, c’était des livres sur Van Gogh, sur la peinture et sur l’histoire de l’art.
À l’École des beaux-arts, on formait un petit groupe dans une grande classe qui se plaignait de la morosité de l’enseignement. À la maison, on réalisait de petites toiles, souvent influencées par Bonnard, Cézanne ou Matisse. Puis un jour, Pierre Gauvreau, un jeune artiste de notre petit groupe, présente un tableau dans une exposition de travaux d’étudiants.
Son tableau est remarqué par Paul-Émile Borduas, peintre et professeur de dessin à l’École du meuble de Montréal (école d’arts appliqués et de production d’ameublement). Fasciné, il a l’impression d’avoir découvert un artiste-né. Il l’invite donc à son atelier. Gauvreau lui demande alors s’il peut venir avec quelques amis.
Un mardi soir de la fin novembre 1941, quatre adolescents et un étudiant un peu plus âgé, tous inscrits à l’École des beaux-arts, mais insatisfaits de son programme d’enseignement, se présentent à l’atelier de Borduas, rue Mentana.
Étrangement, c’est à l’École du meuble de Montréal, où il enseignait, que Borduas sera initié au surréalisme par des collègues déjà au fait de ce mouvement artistique. C’est dans une école de métiers d’art, et non dans une école d’art reconnue, que les idées avancées se sont imposées, car la société québécoise de l’époque était profondément conservatrice, ce que reflétait tout à fait le pouvoir officiel. Nous étions les premiers à nous rebeller publiquement contre ce conservatisme et ce conformisme.
Borduas avait lu le Manifeste du surréalisme (1924) d’André Breton, ainsi que Le château étoile (1936). Il nous parlait avec enthousiasme du groupe d’artistes et de poètes autour de Breton et affirmait que beaucoup d’entre eux fuyaient maintenant Paris, sous occupation nazie en pleine Seconde Guerre mondiale.
Borduas était un pédagogue-né. Venant de peindre une série de gouaches, il expliquait ses tentatives pour parvenir à des formes abstraites, son approche de l’exploration de l’inconscient à travers les théories freudiennes ainsi que de l’écriture automatiste. Cela indiquait qu’un poète ou un peintre surréaliste devait écouter des voix intérieures irrésistibles plutôt que de se soumettre à la froide raison.
Dans un état de réceptivité absolue, le peintre s’abandonne à ses voix intérieures, ne cherchant plus l’inspiration dans la nature, mais dans l’écho de ses rythmes intérieurs, de puissances poétiques obscures, du hasard objectif, du désir ainsi qu’à de la beauté convulsive.
La soirée se prolongeait, personne ne montrait de signes de fatigue, personne ne voulait que cette nuit se termine.
Quoi qu’il en soit, ce soir de novembre a marqué le début d’un nouveau groupe, un groupe avec un but, qui allait devenir le mouvement des Automatistes. Il durera sept ans, sept années magiques ! De novembre 1941 à la publication du Refus global en août 1948, le mouvement bat son plein.
Ces jeunes étudiants et étudiantes étaient Fernand Leduc, Pierre Gauvreau, Louise Renaud, Madeleine Desroches et moi. Bruno Cormier aurait été avec nous, mais ses études académiques l’accaparaient souvent.
Un autre groupe de jeunes intellectuels commença à se joindre à nous à l’occasion, deux ans plus tard. Ce seront : Marcel Barbeau, Jean Paul Riopelle, Jean-Paul Mousseau et Maurice Perron.
ABIGAIL SUSIK : Pourquoi pensez-vous que le surréalisme est devenu important au Canada et au Québec à l’époque de la Seconde Guerre mondiale ?
FRANÇOISE SULLIVAN : Je pense qu’il s’est produit un réveil depuis longtemps nécessaire. C’est évident aujourd’hui lorsqu’on constate les retombées obtenues, tout comme c’était évident à l’époque, pour nous qui le vivions de l’intérieur. Il y avait des groupes intellectuels et artistiques à Montréal, et à ce moment-là, au début des années 1940, ce n’était qu’un début, nous commencions tout juste à prendre conscience de cette nouvelle direction en art. Très vite, tout s’est mis en place de manière fulgurante.
Deux ans plus tard, Borduas a invité à nos rencontres cinq étudiants de son cours de dessin à l’École du meuble : Marcel Barbeau, Jean Paul Riopelle, Maurice Perron, Jean-Paul Mousseau et Guy Viau. Tous, sauf Guy Viau, deviendront des participants actifs de notre groupe, auquel s’est ajouté Claude Gauvreau, le frère de Pierre, pour compléter cette liste d’Automatistes. Par la suite, d’autres artistes, poètes et écrivains se joindront à nous, dont plusieurs étaient las de l’académisme de l’establishment culturel montréalais et commençaient à considérer le surréalisme comme un modèle.
Le journal étudiant Le Quartier latin devient le principal vecteur de cette polémique. Réputé pour la qualité de ses comptes rendus culturels auprès de l’intelligentsia, c’était bien plus qu’une simple publication étudiante. Ses articles témoignaient nettement d’un éveil de la conscience et du but à atteindre. Cependant, nombre de ses articles dépassaient la simple description d’œuvres ou de tendances, délaissant leur mandat pour entrer dans la polémique. Sous-jacent à certains d’entre eux se devinait le postulat d’un combat acharné, une lutte presque à la vie et à la mort contre les forces des ténèbres.
Hors contexte, cela peut sembler exagéré, mais encore faut-il rappeler que ces mêmes peintres avaient tendance à être ignorés ou ridiculisés dans la presse populaire. Et que la culture était abêtissante et que la guerre faisait rage.
En réalité, Borduas s’intéressait surtout aux écrits et aux théories surréalistes, plutôt qu’à ses peintres les plus connus comme Dalí et Matta, dont il avait vu les œuvres à New York. Certaines notions explorées par le surréalisme, notamment celle de l’automatisme, avaient manifestement frappé l’imagination de Borduas. Plus tard, nous aurions des discussions fructueuses sur les liens et les distinctions entre l’automatisme et le surréalisme, car nous avions commencé à les distinguer, en tout cas entre nous.
Dans la revue Amérique française, Maurice Gagnon, bibliothécaire à l’École du meuble, se laisse aller à des formules lyriques telles que « une obscure puissance poétique », et à quelques termes comme « le hasard objectif ». Il invoque aussi la « beauté convulsive » et se réfère à la théorie freudienne : « mettre à jour l’instinct enfoui sous les couches successives et imposantes de la civilisation… ». « Le mystère, la vérité secrète, la vie instinctive de notre être échappait naguère à l’intelligence consciente, à la volonté qui se dresse entre l’homme et sa dangereuse vérité. Sous elle est la surréalité que le rêve ou l’écriture automatique atteignent [1]. »
À partir de ce moment, le mot « surréaliste » sera souvent utilisé dans la presse montréalaise en lien avec Borduas et nous-mêmes.
Au printemps 1942, Borduas et Leduc s’étaient rendus séparément à New York et avaient tenté, sans succès, de rencontrer Breton, qui s’y trouvait. Borduas avait cependant reçu une invitation à rejoindre le groupe de Breton, offre qu’il avait poliment déclinée.
Au cours de ces premières années, Leduc était notre porte-parole le plus actif au Québec, mais nous travaillions tous intensément, dans l’espoir de créer l’œuvre automatiste absolue. J’étais également peintre, mais je m’étais tournée à l’époque surtout vers la danse, ma démarche étant du même ordre. L’enjeu était le même : créer un effet immédiat par un mouvement, simple et fort. Il s’agissait de trouver sa propre vérité, notre propre vérité. S’aventurer dans l’inconnu en gardant le sens du défi formel et imaginatif. Cela agissait comme un aimant sur un groupe qui n’avait pas encore d’identité claire, mais qui était manifestement uni dans un dessein commun.
Ce groupe développait un zèle quasi messianique pour « l’art vivant », comme nous l’appelions, par opposition au conformisme de l’establishment culturel de Montréal, engoncé dans l’académisme des salons européens.
Voici quelques notes de Pierre Gauvreau sur l’automatisme, qui remontent à cette époque : « L’automatisme, en tant que moyen d’investigation de la pensée, nous a été fourni par les surréalistes, par leurs écrits théoriques. La peinture surréaliste, qui est une peinture généralement anecdotique, ne m’a influencé en aucune façon [2]. » Les formes que nous peignions, en tant qu’Automatistes, « ne [provenaient pas] de calculs rationnels, mais [du] libre jeu de l’inconscient [3] ». Comme l’écrivait Gauvreau : « La sensibilité inscrite dans la matière peinte est pour moi le critère de l’authenticité de l’œuvre [4]. »
Entre-temps, après janvier 1945, je suis allée à New York, en quête des écoles de danse les plus intéressantes pour me former.
À Saint-Hilaire cet été-là, certaines des discussions tournaient autour de Leduc, qui avait hâte de discuter de peinture et de théorie, ainsi que des qualités relatives de Matta et de Gorki dans le mouvement surréaliste. Au Québec aussi, les discussions étaient très animées.
ABIGAIL SUSIK : Comment des Canadiens et Canadiennes comme vous et Les Automatistes ont-ils transformé le surréalisme ? En d’autres termes, comment avez-vous intégré les idées et les éléments surréalistes pour vous les approprier ? Ou, autrement dit, quels sont les traits distinctifs du surréalisme, ou des adaptations du surréalisme, au Canada ?
FRANÇOISE SULLIVAN : Pour nous, il s’agissait d’une ouverture sur un nouveau monde à explorer. L’idée de « magie » et ce que nous pouvions trouver de magique par l’art, un nouveau monde et de nouvelles façons d’aborder l’art sont nés de notre immersion dans le surréalisme, laquelle allait de pair avec un nouveau vocabulaire, tel que « l’inconnu », « l’extatique », etc. On le voit par exemple dans les poèmes de Thérèse Renaud, publiés dans son recueil Les sables du rêve en 1946, illustrés par Jean-Paul Mousseau pour Les Cahiers de la file indienne, une petite maison d’édition lancée par les poètes Gilles Hénault et Eloi de Grandmont. Les poèmes s’inscrivent principalement dans la tradition de ce que l’on pourrait appeler la « poésie surréaliste onirique » et s’apparentent à ceux publiés dans les revues surréalistes.
Mousseau les a illustrés dans la foulée de l’iconographie surréaliste, mais l’année 1945 semble être une année charnière puisque la plupart des artistes de l’automatisme commencent à s’éloigner de cette construction plutôt cubiste. Bientôt, il n’y aura plus de figuration, plus d’indice de volume, plus d’éléments à lire, plus de ligne d’horizon. Le surréalisme nous a donné des pistes sur la manière de réaliser ce que nous avons appelé « l’automatisme », en fait un mouvement artistique complet, à l’avant-garde de ce qui pouvait se faire à l’époque. Nous avons fusionné l’irrationnel et le rationnel dans notre travail, l’avant-plan et l’arrière-plan se confondant délibérément dans l’ensemble de nos œuvres.
L’évolution de la manière de dessiner de Mousseau au fil du temps illustre bien le changement avant-gardiste menant à l’abstraction. On y voit la transformation de ce qui fut d’abord le surréalisme pour devenir ensuite l’automatisme, ce qui ressemble beaucoup au processus ayant mené à ce qu’on a appelé l’expressionnisme abstrait aux États-Unis.
Comme l’a souligné Fernande Saint-Martin, l’automatisme québécois et l’expressionnisme abstrait américain se sont développés à la même époque de manière simultanée et en parallèle, et ont commencé par une réflexion sur le cubisme et le surréalisme, suivie d’un approfondissement de la notion d’automatisme pictural [5]. Je crois qu’il faut insister davantage sur ce point à l’extérieur du Québec.
Le sentiment d’être à la fine pointe, d’être en avance plutôt qu’à la traîne, de n’avoir absolument aucun modèle, aussi immédiat ou illustre soit-il, d’être entièrement et complètement seul, était en effet stimulant pour nous ; d’être aux avant-postes d’un développement artistique que nous pressentions être de la plus grande importance, même si très peu de gens le savaient à l’époque. Nous ne connaissions personne qui faisait la même chose que nous. Il est intéressant de connaître les objectifs d’un ou d’une artiste et les raisons pour lesquelles il ou elle choisit de travailler d’une certaine manière.
En tant qu’artiste, on le sait quand on se trouve devant un ensemble de qualités qui sont intéressantes. C’est un sentiment que l’on éprouve lorsque les choses tombent en place. C’est le choc produit lorsqu’on reconnaît avoir réussi à reproduire des images d’abord ressenties intuitivement.
En tant qu’artiste, on tente de plonger dans l’inconscient, c’est-à-dire d’inventer à partir de son expérience personnelle et de son être, de créer à partir de son univers intérieur. L’œuvre intègre alors une partie du moi de l’artiste.
ABIGAIL SUSIK : Certains de vos premiers spectacles de danse, tels que Le spectre de la rose (vers le début des années 1940) et les chorégraphies Moi je suis de cette race rouge et épaisse qui frôle les éruptions volcaniques et les cratères en mouvement (1948) et Dualité (1948), ont-ils été influencés par le surréalisme ? Ou ont-ils été plutôt influencés par le groupe automatiste dont vous faisiez partie ?
FRANÇOISE SULLIVAN : Le spectre de la rose et Moi je suis de cette race rouge et épaisse… ne sont pas surréalistes.
L’œuvre Moi je suis de cette race rouge et épaisse… a été chorégraphiée et dansée par Jeanne Renaud et moi-même en guise de conclusion au récital de danse que nous avions présenté à la Maison Ross. Il a été dansé sur un poème de Thérèse Renaud, la sœur de Jeanne, tiré de son recueil de poésie Les sables du rêve (1946). Le poème était lu par Claude Gauvreau pendant la représentation. En fait, à mon avis, cette chorégraphie est vaguement surréaliste et automatiste, mais pas tout à fait aboutie.
Dualité, par contre, est sans aucun doute surréaliste. L’œuvre a été créée à la suite d’un rêve que j’avais fait. Une belle fille est montée sur un cheval ; à côté d’elle se trouve une autre fille, plutôt misérable. Pourtant, elles se ressemblent d’une certaine manière. Dans cette danse, deux danseuses entrent sur scène liées l’une à l’autre, tournant sans cesse sur elles-mêmes vers l’autre bout de la scène puis s’arrêtent, se plient et fléchissent avant de se séparer. Ensuite, elles font des mouvements en miroir, semblables, mais différents dans leur essence. Il y a des moments de colère, puis des moments où leurs affinités apparaissent, impossibles à nier. À la fin, la force d’attraction les ramène ensemble et la pièce se termine comme elle a commencé.
Inspirée du mythe de la déesse Janis, elle symbolise les deux visages d’une même personne, à la fois méchante et bonne. Il existe de multiples lectures de cette chorégraphie. Le sujet de cette pièce était donc évidemment surréaliste, tout comme la façon dont il m’est apparu en songe. Franziska Boas était très intéressée par cette création. Elle en voyait la source d’inspiration dans la théorie freudienne de l’inconscient.
ABIGAIL SUSIK : Lorsque vous étiez à New York entre 1945 et 1947, le surréalisme était-il dans l’air du temps dans vos cercles artistiques de l’époque (avec Boas, Graham, etc.) ?
FRANÇOISE SULLIVAN : Je n’ai pas vraiment le souvenir que le surréalisme ait été ouvertement présent dans mes cercles artistiques à New York lorsque je fréquentais le studio de Boas. Cependant, je pense qu’il était implicite, car nous avions des cours d’improvisation tous les jours. À cette époque, dans ma pratique de danse à New York, j’ai dû m’affranchir de la technique du ballet qui était tellement ancrée en moi depuis l’enfance. À New York, je me suis d’abord inscrite au New Dance Group, où enseignait la nouvelle génération. J’ai également suivi quelques classes de danse indienne avec La Meri et de danse africaine avec Pearl Primus, récemment revenue d’Afrique, ainsi que des classes avec Hanya Holm et Martha Graham. Au studio de Franziska Boas, il y a également eu des improvisations musicales sur les instruments du monde entier de son immense collection, entre autres avec le musicien Norton Feldman.
ABIGAIL SUSIK : Dans son livre sur la période où vous étiez à New York, Allana Lindgren mentionne que vous vous intéressiez à Jung et à Freud à la fin des années 1940 ? [6] Est-ce que cela transparaissait dans votre travail à l’époque ? Comment cela se manifestait-il ?
FRANÇOISE SULLIVAN : À New York, à la fin des années 1940, je me souviens que tout le monde s’intéressait à Jung et à Freud. Tout le monde parlait de rêves, tout le monde voulait voir un psychanalyste. Ces théories ne se manifestaient dans mon travail que par le truchement des rêves et de la poésie. Je me souviens qu’un soir, après la classe d’improvisation, j’ai voulu continuer à danser toute la nuit, mais on m’a arrêtée à 22 h 30. Cette fois-là, en fait, j’étais en transe. La chorégraphie de Dualité ainsi que celle de Danse dans la neige (1948) se rapprochaient sûrement de la théorie freudienne.
ABIGAIL SUSIK : Quand avez-vous étudié avec Alfred Pellan à l’École des beaux-arts de Montréal ? Il a commencé à y travailler en 1943. Comment cela s’est-il passé, puisque la vision du surréalisme de Pellan était très différente de celle de Borduas ? Enfin, avez-vous connu [Mimi] Parent et [Jean] Benoît ?
FRANÇOISE SULLIVAN : Pellan était rentré à Montréal. Il avait vécu quelque temps à Paris où il s’était mêlé à sa brillante communauté artistique. Il est revenu à Montréal en 1941, auréolé de l’éclat de sa période parisienne.
Je ne me souviens pas en quelle année j’ai suivi le cours de peinture de Pellan, mais ce devait être vers 1944. Je devais suivre ce cours pour obtenir mon diplôme de l’École des beaux-arts, tout comme Leduc l’avait fait avant moi. Je sais seulement que c’est l’année où Fernand Léger est venu à Montréal pour y présenter son film, Ballet mécanique (1924).
Je ne me souviens pas non plus d’avoir entendu Pellan parler de surréalisme. En classe, nous faisions du modèle vivant, mais nous étions libres de peindre comme nous le voulions, et il nous donnait à chacun et chacune des commentaires sur la direction que nous prenions. Je ne me souviens pas d’avoir eu à suivre une direction en particulier.
Mimi Parent et Jean Benoît suivaient également ce cours. Jean Benoît travaillait sur une grande œuvre horizontale représentant l’enfer. Mimi Parent était aussi dans la même classe, et Jacques de Tonnancour, plus âgé, était la vedette de l’école. Ils étaient tous sympathiques avec moi, espérant peut-être me rallier à leur camp. Mes amis n’étaient pas contents à l’époque.
ABIGAIL SUSIK : Quelle est la différence entre l’interprétation du surréalisme par Pellan, d’un point de vue canadien ou québécois, et celle de Refus global, dont vous avez fait partie à partir de l’été 1948 ?
FRANÇOISE SULLIVAN : Dans les deux camps, l’approche du surréalisme en peinture était très différente. En 1945, nos œuvres expérimentales surréalistes commençaient à évoluer vers l’abstraction. Rétrospectivement, je pense que c’était là une date extrêmement précoce. L’atelier de Leduc, puis celui de Barbeau et de Riopelle, puis à son tour celui de Mousseau devenaient le soir des lieux de rencontres et de discussions animées qui attiraient des intellectuels, poètes et autres artistes, et parfois même des journalistes et des communistes.
Le manifeste Prisme d’Yeux (1948) n’a jamais été pensé pour soutenir un mouvement cohérent au même titre que l’automatisme. Il annonçait rechercher « une peinture libérée de toute contingence de temps et de lieu, d’idéologie restrictive et conçue en dehors de toute ingérence littéraire, politique, philosophique ou autre qui pourrait adultérer l’expression et compromettre sa pureté [7] ». Il n’a jamais débouché sur aucune action au-delà d’une déclaration publique et d’une exposition de peintures. La différence entre les interprétations des deux mouvements est que l’on peut constater que d’une part, le groupe de Pellan était distant, et d’autre part, que les Automatistes étaient passionnés et profondément engagés dans la peinture et l’acte de création. Il y a une différence d’intensité. En effet, notre groupe cherchait à définir ce qu’est la peinture, ce qui l’a mené à l’automatisme. La démarche impliquait une série d’étapes allant de la figuration à l’abstraction.
Le fait que Pellan et Borduas ne s’entendaient pas semble bien connu. D’autres signataires de Prisme d’Yeux, comme Jean Benoît et Mimi Parent, estimaient tout simplement que les Automatistes étaient trop intellectuels à leur goût et trop préoccupés par les « problèmes » de la peinture, selon eux. Nous n’étions pas d’accord, bien entendu. Borduas n’a jamais pris cela trop au sérieux.
Le 30 janvier 1948, Leduc révise une lettre qu’il avait écrite en 1946 à André Breton et qui annonçait la rupture des relations. Il espérait alors publier cette lettre dans un périodique surréaliste parisien en 1947 sous le titre « Rythmique du dépassement et notre avènement à la peinture », mais cela ne s’est jamais fait. Il tentera de la publier à nouveau en 1948, sans succès, ce qui prouve que les tensions étaient toujours palpables.
ABIGAIL SUSIK : Avez-vous connu Alan Glass ? Et quelle était votre vie à Montréal au retour de New York, à l’époque de Danse dans la neige ?
FRANÇOISE SULLIVAN : Je ne me souviens pas d’avoir rencontré Alan Glass.
J’étais certainement à Montréal en même temps qu’Alan Glass, en 1949, depuis mon retour de New York à la fin juin 1947, où je préparais un autre spectacle de danse. J’étais revenue, en effet, parce que j’avais pris conscience que des choses allaient se passer ici.
Notre groupe estimait que notre production artistique faisait partie de l’avant-garde et donc, par définition, il s’agissait d’un acte de révolte. Nous avons été rebelles et avons affronté les personnes haut placées : gouvernements, archevêques, communautés religieuses, etc. Leur vision en général et à l’égard de l’art en particulier était oppressive, démodée et moralisatrice. Nous estimions que notre cause était urgente et noble. Il y avait quelque chose dans l’air qui n’était pas encore bien défini. Et eux avaient le pouvoir officiel de nous réprimer, qu’ils ont parfois utilisé.
Pour ma part, au cours de l’été 1947, j’ai trouvé un studio et j’ai commencé à donner des cours de danse moderne et à travailler à de nouvelles oeuvres. J’ai travaillé à mes chorégraphies Black and Tan (d’après Black and Tan Fantasy de Duke Ellington), puis à Dédale, Dualité, Gothique et d’autres. Le groupe se réunissait de temps en temps, et nous discutions de beaucoup de choses, mais je ne participais pas toujours à ces discussions, car j’étais très occupée.
Pendant les vacances de Noël, j’ai travaillé à mon essai, La danse et l’espoir. J’ai été surprise qu’on me demande de le présenter publiquement le lundi 16 février 1948, car je trouvais qu’il avait besoin d’être peaufiné.
Le 26 février, je croise Riopelle à une conférence. Il rentre de Paris avec sa femme, et il me demande ce que j’ai fait depuis notre dernière rencontre. Je lui parle d’une danse sur la mer que j’ai faite l’été précédent. Elle a été créée pendant des vacances avec mes parents, et j’ai pris soin d’apporter notre Bolex 16 mm dans l’espoir de filmer quelque chose que j’avais en tête, sans savoir précisément quoi. Cette danse se déroule dans un village perdu appelé Les Escoumins, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, où se trouve une petite île de rochers en granit rose, non loin de la rive.
Un jour, j’enfile un vêtement rouge et je commence à danser sur cette île, en plein soleil, là où les baleines font jaillir de l’eau, en sautant et en virevoltant. Je danse avec les baleines et mes cheveux prennent feu sous le soleil. J’avais demandé à ma mère de filmer cette extravagance, et elle l’a fait, aimant participer avec sa fille à cet événement si… surréaliste.
Alors, quand j’ai croisé Jean Paul Riopelle à la conférence ce soir-là, je lui ai dit que j’aimerais faire une danse dans la neige. Spontanément, il me répond : « Viens demain ! » En effet, il avait loué une petite maison avec sa femme à Otterburn Park, près du mont Saint-Hilaire. Voilà donc les prémices de Danse dans la neige, que j’évoquerai plus loin dans notre entretien.
Quelque temps après, j’ai téléphoné à Jeanne Renaud, la sœur de Louise, qui étudiait la danse à New York, pour lui demander si elle aimerait présenter certaines de ses chorégraphies dans un petit récital que je souhaitais présenter à Montréal, ce qu’elle a accepté.
Le Récital de danse a eu lieu le 3 avril 1948 à la Maison Ross, où se trouvait également mon studio. Le groupe avait accueilli l’idée avec enthousiasme et tout le monde voulait participer : Mousseau créa une scène avec des mètres et des mètres de jute ainsi qu’un costume ; Riopelle décida d’assurer la régie, Claude Gauvreau de réciter le poème de Thérèse ; Pierre Mercure de créer la musique et Maurice Perron de s’occuper des éclairages.
Après le Récital de danse, le groupe des Automatistes était alors en gestation et préparait activement une importante exposition de ses toiles récentes. Cependant, Borduas était en train d’écrire un texte abordant des questions sociales et le groupe a décidé de publier un manifeste au lieu de faire l’exposition, rassemblant à la dernière minute des textes et des idées que nous avions et qui étaient en ébullition depuis si longtemps. Il n’y a eu ni réunion formelle ni plan d’action pour décider de ce qu’il fallait y inclure. Mais le texte de Borduas était virulent. J’ai été surprise que le groupe décide d’inclure mon essai, La danse et l’espoir, qui était certes moins provocateur que le texte principal de Borduas, tout en ayant sans aucun doute un lien avec lui. À la veille d’assembler le contenu, certains membres auraient préféré qu’il fût moins politique. Riopelle, par exemple, argumente, s’écriant : « Il s’agit de peinture ! De peinture ! La peinture ! » Mais il y a participé et divers textes ont été rassemblés. Le manifeste fut donc publié et il abordait davantage la sphère sociale.
Le 9 août, la publication était lancée à Montréal aux éditions Mithra-Mythe, à 400 exemplaires. Le succès fut immédiat, autant dans les cercles artistiques et intellectuels que dans la communauté socialiste. Presque tous les exemplaires furent vendus en quelques jours.
Peu de temps après, l’essence du texte atteignit les hautes sphères du gouvernement, et les conséquences furent désastreuses. Malheureusement, en l’espace de quelques semaines, Borduas perdit son emploi, sa famille, sa santé, mais conserva ses amis, même si le groupe semblait prendre ses distances.
Malgré son incidence considérable sur la société et les répercussions dramatiques auxquelles ses membres ont dû faire face en 1948, le manifeste a été oublié pendant près de 10 ans, jusqu’à ce qu’un groupe d’artistes et d’intellectuels le fassent renaître et s’en inspirent, ce qui a mené à la Révolution tranquille au Québec. Depuis, il est resté très vivant dans la mémoire collective. Aujourd’hui encore, il est enseigné dans les collèges et les universités comme un document d’une grande importance sociale.
ABIGAIL SUSIK : La formation d’un nouveau mythe est l’une des idées de Borduas qui est au cœur du manifeste Refus global. Qu’entendait-il par là ? Pensez-vous que Borduas ait, à cet égard, été influencé par Breton ?
FRANÇOISE SULLIVAN : Bien que la formation d’un nouveau « mythe » soit l’un des mots clés du Refus global de Borduas et que les idées d’André Breton sur le sujet lui soient connues, aucun des deux n’a pu se mettre d’accord sur la manière dont cela se produirait ou devrait se produire. La position de Breton à l’égard de la peinture était incompatible avec le point de vue des Automatistes.
Breton s’opposait à la dérive vers l’abstraction pure en Amérique dans les années 1940, laquelle, selon lui, « d’ordinaire sert les buts plus qu’impurs de la réaction [8] ». Je ne peux pas être d’accord avec cela, et le groupe ne l’a pas été non plus à l’époque ou par la suite.
À une époque antérieure, Apollinaire écrivait à Breton : « Je suis d’avis que l’art ne change point et que ce qui fait croire à des changements ce sont les efforts que font les hommes pour maintenir l’art à la hauteur où il ne pourrait pas ne pas être [9]. » C’est Apollinaire qui, des années auparavant, avait utilisé pour la première fois le mot « surréalisme » dans ses écrits sur « l’orphisme » de Delaunay et dans le manifeste de 1913, L’antitradition futuriste.
ABIGAIL SUSIK : Pourquoi Borduas avait-il refusé l’invitation de Breton à participer à la 6e Exposition internationale du Surréalisme (qui avait pour thème le mythe) à la Galerie Maeght à Paris en 1947 ?
FRANÇOISE SULLIVAN : Toutes les tentatives pour rencontrer André Breton avaient échoué, et lorsque Breton se rendit à Gaspé, au Québec, en passant par Montréal, il ne manifesta aucun signe de vouloir rencontrer Borduas, Leduc ou le groupe.
Les raisons sont donc nombreuses pour expliquer pourquoi Borduas avait décliné l’invitation de Breton à participer à la 6e Exposition internationale du Surréalisme à la Galerie Maeght à Paris en 1947. Peut-être aurait-il dû accepter de toute façon parce que l’exposition était prestigieuse, mais il a estimé qu’il convenait de refuser. Riopelle, quant à lui, accepta, même s’il n’était plus proche de Breton. C’est là qu’il rencontra Pierre Maeght et d’autres personnes importantes pour sa carrière. Mais Borduas avait alors 39 ans et Riopelle 23.
ABIGAIL SUSIK : Dans votre danse La femme archaïque (1947-1948), vous abordiez également le mythe et l’idée de la femme primordiale. Pouvez-vous nous parler un peu de cette œuvre chorégraphique et des idées qui s’y rattachent ?
FRANÇOISE SULLIVAN : Ma chorégraphie La femme archaïque n’était pas la seule à aborder le thème du mythe et de la féminité. Et La nuit à la nuit (1981) était certainement plus clairement mythique, car elle faisait appel à un grand groupe de femmes, et certains mouvements et gestes étaient inspirés par des peintures rupestres préhistoriques et des figurines de Vénus du paléolithique européen. Je ne sais pas vraiment pourquoi j’ai choisi ce thème. Il m’avait inspirée en quelque sorte.
ABIGAIL SUSIK : Lindgren mentionne également votre intérêt pour l’expression instinctive des émotions à travers la danse. La danse automatiste a-t-elle pour objet l’expression des émotions ?
FRANÇOISE SULLIVAN : En danse, on peut apprendre des pas, des mouvements, et cela peut être aride ; ou on peut y engager tout son être. C’est ce que j’ai choisi.
ABIGAIL SUSIK : Quand je vous ai rencontrée au Metropolitan Museum of Art, vous m’aviez dit avoir été en transe pendant la représentation et le tournage de Danse dans la neige. Pourquoi ? Quels sentiments et sensations éprouviez-vous pendant que vous dansiez ?
FRANÇOISE SULLIVAN : Ce jour-là, toute la campagne semblait frémissante. L’air rougissait nos joues. Le sol était rugueux et glissant sous nos pieds tandis que Jean Paul (Riopelle) et Maurice (Perron) s’attelaient silencieusement à leur tâche.
Oubliant les neiges familières à nos jeux d’enfants, je me tenais là prête à oser, ne sachant pas quoi oser, mais osant tout de même. Sans règle, sans guide. J’ai affronté ce terrain raboteux et j’ai sondé l’abîme qui était en moi. J’ai dévalé la colline hérissée et glissante et j’ai dansé jusqu’au paroxysme de la danse, comme si la danse n’avait jamais existé.
J’ai couru de colline en colline, j’ai caressé leur surface lunaire, j’ai laissé venir les mouvements, vigoureux dans le froid, chargés de leur résonance avec l’espace.
Et c’est là que la rudesse du pays et la beauté sublime du nord convergèrent, dans une étreinte extatique.
J’ai suivi leur logique, gonflée de rêves. Des oiseaux volaient, des herbes craquaient sous mes pieds, les mouvements se succédaient dans le feu de l’action. J’ai salué un long nuage qui planait sous le soleil. Le soleil s’étant couvert en fin d’après-midi, les gestes sont devenus évocateurs et une mélancolie nordique s’est lentement instaurée comme dans un songe.
ABIGAIL SUSIK : Votre magnifique ekphrasis donne vie à Danse dans la neige dans mon imagination.
Dédale (1948) était-elle liée à ce concept de danse surréaliste-automatiste ?
FRANÇOISE SULLIVAN : Dédale est mon œuvre préférée, car c’est un exemple d’automatisme psychique pur dans la façon dont la pièce est née de rien et a évolué à partir du poids et de l’impétuosité du corps lui-même, pour devenir un tout mystérieux. Elle est née d’un mouvement inconscient d’une main qui a grandi, grandi, jusqu’à entraîner le corps tout entier dans la danse.
Je voudrais ajouter quelques mots en guise de conclusion :
Nous nous considérions comme l’avant-garde. Nous avions d’abord adhéré au surréalisme, qui était alors le mouvement le plus avancé, mais nous avons cherché à aller plus loin. La conscience d’être à la limite, d’être en avance plutôt qu’à la traîne, de ne pas avoir de modèle, d’aller à la rencontre, de sentir des images d’abord ressenties intuitivement.
Notre ami Gilles Hénault a mis ces mots sur nos réflexions, et c’est devenu notre devise :
« NOUS SOMMES PRÊTS À POURSUIVRE AVEC TOUTE LA VIGUEUR POSSIBLE UNE ROUTE DONT NOUS SAVONS SEULEMENT QU’ELLE N’A PAS ÉTÉ PARCOURUE AVANT NOUS. […] CELA IMPLIQUE DONC, DANS LE DOMAINE DE LA PENSÉE ET DE L’ART, UNE RÉVOLTE CONSTANTE CONTRE LES SOLUTIONS FIGÉES ET TOUTES FAITES [10]. »
Je terminerai par ces quelques mots de Borduas :
ET QUEL EST LE RÔLE DE L’ART DANS TOUT CELA ?
L’art aide les êtres humains à se situer dans les grands mouvements de l’histoire et de la pensée. Leur importance n’est pas dans leur existence en tant qu’objets, mais dans le fait qu’ils sont les témoins de la spontanéité et de la nécessité de l’art vivant.
[1] Maurice Gagnon, « Borduas », Amérique française, vol. 1, no 6 (mai 1942), p. 10-13.
[2] Tancrède Marsil, « Gauvreau, automatiste », Le Quartier latin (28 novembre 1947), p. 5.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Fernande Saint-Martin, « Le sujet de la peinture et l’automatisme de Borduas », RACAR : Revue d’art canadienne / Canadian Art Review, vol. 7, nos 1-2- (1980), p. 4-14.
[6] Allana Lindgren, From Automatism to Modern Dance: Françoise Sullivan with Franziska Boas in New York, Toronto, Dance Collection Danse, 2003.
[7] « Manifeste Prisme d’Yeux » (1948), cité par Guy Robert dans Pellan, sa vie et son œuvre, Montréal, Éditions du Centre de psychologie et de pédagogie, 1963, p. 49, 51.
[8] André Breton et Diego Rivera, « Manifeste pour un art révolutionnaire indépendant » (1938), dans Mary Ann Caws (dir.), Manifesto: A Century of Isms, Lincoln, University of Nebraska Press, 2001, p. 472-77.
[9] Guillaume Apollinaire, « Lettre à André Breton », 29 février 1916, Le poète assassiné, Paris, L’Édition, Bibliothèque des curieux, 1916), p. xiii–cix.
[10] Gilles Hénault, « Projets pour une série de cahiers sur l’automatisme » (1946), Regards sur l’art d’avant-garde, Montréal, Les Éditions Sémaphore, 2016, p. 105.
ABIGAIL SUSIK
À travers un vaste champ de recherches consacrées à l’histoire de l’art moderne et contemporain et aux arts visuels, ABIGAIL SUSIK s’intéresse particulièrement au croisement entre le surréalisme international et ses manifestations contre l’autoritarisme culturel. Elle est l’autrice de Surrealist Sabotage and the War on Work (Manchester University Press, 2021), directrice de la publication Resurgence ! Jonathan Leake, Radical Surrealism, and the Resurgence Youth Movement, 1964–1967 (Eberhardt Press, 2023), et co-directrice des publications Surrealism and Film after 1945: Absolutely Modern Mysteries (Manchester University Press, 2021) et Radical Dreams: Surrealism, Counterculture, Resistance (Penn State University Press, 2022). Abigail Susik est membre fondatrice du conseil d’administration de l’International Society for the Study of Surrealism (la Société internationale pour l’étude du surréalisme) et professeure associée d’histoire de l’art à la Willamette University (États-Unis). Elle est boursière du National Humanities Center pour l’année 2023-2024.
FRANÇOISE SULLIVAN (1923- ) est originaire de Montréal, où elle a étudié à l’École des beaux-arts. Cette artiste aux multiples facettes s’est d’abord fait connaître comme danseuse et chorégraphe, avant de bifurquer vers la sculpture et l’art conceptuel dans les années 1960 et 1970, puis de revenir à la peinture dans les années 1980, une pratique qu’elle poursuit encore aujourd’hui. Avec Paul-Émile Borduas, elle a été l’un des membres fondateurs du mouvement d’avant-garde Les Automatistes, ainsi que l’un des cosignataires du manifeste Refus global en 1948, qui comprend l’intégralité de son célèbre essai intitulé La danse et l’espoir. Son travail a fait l’objet d’innombrables expositions individuelles et collectives, notamment au Musée d’art contemporain de Montréal (1981 et 2018), au Musée national des beaux-arts du Québec (1993), au Musée des beaux-arts de Montréal (2003 et 2023), au MoMA (2010) et au Metropolitan Museum of Art (2021-2022) à New York, ainsi qu’à la Tate Modern à Londres (2022). Elle a reçu de nombreuses distinctions et des prix prestigieux, dont le Prix du Gouverneur général et l’Ordre du Canada.